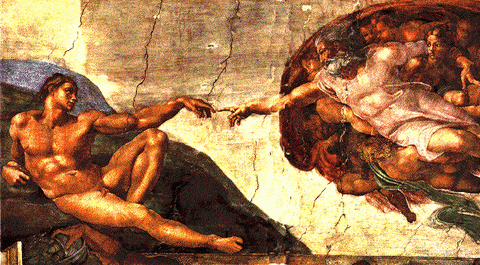Surtout, restez comme vous êtes.
Ne vous égarez pas dans les vapeurs des discours branchés qui vous feraient prendre l’écriture pour une activité réservée aux élus.
Vous faites de toute façon partie des élus! Du moins si tel est votre désir. N’en déplaise aux experts jeteurs de sorts et d’anathèmes que Wikipedia, l’encyclopédie ouverte, prive de leurs privilèges!(cf la polémique actuelle).
Il n’est qu’à tendre la main et à ouvrir l’oeil.
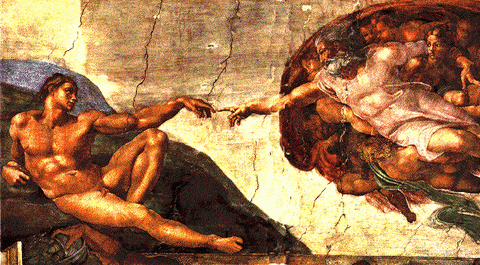
Descendre ensuite du nuage pour travailler la matière.
Puis, emprunter le chemin tracé par Kadaré.
Dans « La légende des légendes », que malheureusement vous ne trouverez plus en librairie, l’écrivain nous fait visiter avec humour les soubassements très matériels de la naissance de l’écriture. Passage du monde éthéré de la parole souveraine, de l’intellect insaisissable, à l’univers de poussière, à l’humble tablette d’argile si dure à graver, si lourde à porter…Mais on aurait tort de se morfondre. Kadaré nous fait rire dans un domaine où traditionnellement la gravité est de mise. Profitons en.
Tableau du pauvre poète aux prises avec la matière :
(Texte à garder soigneusement.)
La légende des légendes
Ismail KADARE, Flammarion p.56-66
Il y a quelque trois mille ans, la domination absolue de ce que l’on pourrait appeler la culture de l’oreille fut menacée pour la première fois par l’intervention de l’œil, autrement dit par l’invention de ce qui devait ne pas être entendu, mais être vu par lui, l’écriture.
Il s’agit là sans aucun doute de la plus grande innovation qui ait vu le jour dans la création spirituelle de l’humanité. Ce fut une rupture, un bond, un dépassement d’une telle dimension que toute innovation postérieure dans l’art d’écrire devait paraître négligeable comparée à elle.
Comme nous l’avons dit plus haut, nous ne connaissons pas le drame, ou mieux la rébellion qui s’est produite. Nous savons seulement que dans un mythe grec l’apparition des caractères a été imaginée comme une poignée de dents de dragon jetées dans un champ. L’écriture a donc a été perçue dès ses commencements comme quelque chose de dur et d’impitoyable, ce que l’on a vu confirmer plus d’une fois dans l’histoire de ce monde.
Néanmoins, il convient de dire que, comme toute nouvelle dissidence, il y a beaucoup de chances pour qu’elle ait été à ses débuts timide.
Dans Le Monstre, l’un de mes premiers romans, qui date de 1965, j’ai pris goût à imaginer la naissance de l’écriture comme une nouvelle mode qui vient rompre la tranquillité et la sérénité des rhapsodes, alors maîtres de la création. Troublés par cette invention démoniaque, ils courent les uns chez les autres, se réunissent, se mettent en colère, puis vont frapper aux portes des hommes de pouvoir pour réclamer l’interdiction, tant qu’il n’est pas trop tard, de l’écriture.
Revenant à ce qui peut s’être produit à l’époque entre les tenants de la création orale et ceux de l’écrite, je pense que nous ne serons pas loin de la vérité en continuant d’imaginer que leurs rapports ont dû être marqués par une forte friction, et sûrement par bien des intrigues et des sanctions. (Les légendes et les anciens poèmes épiques abondent en concours de rhapsodes, qui, invités chez le prince, attendent de lui une récompense.)
Dans cette longue histoire, il y a toutes les chances pour qu’aèdes et rhapsodes se soient moqués au début de ces aventuriers ridicules, qui savaient fixer leurs pensées sur quelques tablettes d’argile, au moyen de certains signes qui ressemblaient fort aux traces de pieds de poule.
En fait, les raisons pour les railler abondaient. A commencer par la préparation des tablettes, autrement dit de ce qui faisait fonction pour eux de ce qu’est le papier pour nous, et que les malheureux poètes d’alors, plus souillés que les potiers, étaient contraints de préparer avec des seaux remplis de boue d’argile, souvent sous les moqueries malveillantes des badauds. Puis, sur ces tablettes, ils gravaient des signes que l’on appelait « lettres » et qui, selon eux, fixeraient dans l’argile leur inspiration poétique. Il y avait vraiment de quoi pouffer de rire car, en fait, il était inconcevable qu’une création de si haute tenue, divine même, don des Muses, comme était le poème ou la légende, fût mêlée à cette boue et à cette éclaboussure sans fin. Certes, il y avait là quelque chose de risible, mais à la fois de malfaisant, une sorte d’outrage des cieux, de désir de tout traîner dans la boue, en tout cas un élément maléfique, d’inspiration infernale.
Mais ce n’était là que le début du mal. Après le grattage des tablettes, après donc que le poème eut été reproduit sur elles, le poète devait allumer le four
pour cuire ces plaques, ce qui était un travail harassant. La fumée et la suie noirciraient ce qui n’avait pas encore été souillé par la boue dans sa maison. Lui-même se brûlerait les mains durant la cuisson, et les plaques, une fois retirées et empilées, encombreraient encore plus son logis déjà sens dessus dessous, d’autant plus que sa femme, excédée après de nombreux avertissements, l’avait finalement quitté.
Si, même après cela, il recouvrait une certaine tranquillité, il aurait à affronter de nouveaux tracas, dont chacun à lui seul aurait fait perdre la raison à quiconque. Ainsi le transport d’un poème jusqu’au marché de la ville ou à une soirée entre amis, ou au concours annuel de poésie, serait à lui seul une aventure. Ce que les rhapsodes accomplissaient de manière aussi noble et céleste quand ils se rendaient un peu partout, à un banquet, à des célébrations importantes ou au bureau de la censure avec leur poème en tête, les malheureux scribes, eux, devaient le charger sur un chariot, puis le décharger, toujours sous les regards et les lazzis des badauds.
Les tablettes empilées dans l’habitation du poète formaient souvent de vrais murs. Le gel de l’hiver et la neige venaient battre contre eux et il n’était pas rare qu’un tremblement de terre ou simplement un empilage hâtif causât un jour la chute des tablettes, ensevelissant alors le poète lui-même. Ainsi, pratiquement, l’écrit mettait à nu ce que jusqu’alors le poète avait gardé caché: les malheurs que pouvait engendrer la poésie.
C’est sans doute ainsi qua été maltraitée et méprisée la littérature écrite pendant plusieurs siècles. Mais, peu à peu, elle commença à s’affirmer. Les plaquettes d’argile devenaient de plus en plus minces et légères. Pour transporter un poème ou un récit jusqu’au banquet où l’on était invité, ou bien jusqu’à la censure, il n’était plus besoin d’un char traîné par des bœufs, mais d’un sac que quiconque de plus ou moins normal avait la force de porter. Puis, quand les caractères commencèrent à être gravés sur des peaux tannées, et surtout après la découverte du papyrus, on s’aperçut que l’heure n’était plus à la plaisanterie. Désormais non seulement les poèmes et les contes étaient transportés un peu partout avec la plus grande facilité, mais on pouvait même leur faire franchir les frontières, en cachette, enfouis dans des frusques. Bien entendu, ils occupaient encore beaucoup plus de place que les plus longs poèmes épiques dans la mémoire d’un aède, mais ils comportaient certains avantages. L’un, et probablement le principal, tenait à leur sécurité et à leur avenir. Tracés sur des peaux ou sur le papier, et surtout quand, recopiés, ils étaient placés en divers lieux, ils offraient le maximum de sûreté. L’aède pouvait connaître subitement un mauvais sort, mourir accidentellement, être blessé à la tête, avoir la langue paralysée, ou simplement perdre la raison, et dans ces cas-là le trésor qu’il portait en lui disparaissait.
Et, en vérité, le temps où l’on se moquait des scribes était révolu. Bien plus, l’heure de leur revanche, semblait-il, était venue.
La revanche de l’écriture fut longue et obstinée. Dans la succession des siècles, les aèdes et les rhapsodes perdaient toujours plus de leur prestige et de leur fierté. Certains se muèrent progressivement en chanteurs ambulants et leurs riches rétributions d’antan se réduisirent peu à peu à quelques aumônes que les passants leur donnaient plus par charité que par estime pour leur art. Leur déchéance allait s’aggravant, au point qu’ils en furent réduits à composer des poèmes sur commande, et des commandes souvent humiliantes. Eux qui avaient chanté de glorieux affrontements de souverains ou de démons consentaient maintenant humblement à composer un long poème à la gloire d’un fabricant de vin, ou de la femme du directeur des postes d’une petite ville perdue de province.
En loques, souvent aveugles (l’étaient-ils vraiment ou la cécité n’était-elle qu’un vieux symbole qu’ils croyaient devoir honorer, ou encore le signe qu’ils avaient accepté d’être vaincus par l’œil?), chassés des métropoles d’Europe, les rhapsodes arrivèrent jusqu’au xxe siècle, surtout dans les pays arriérés.