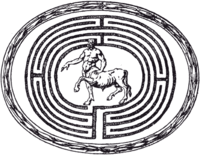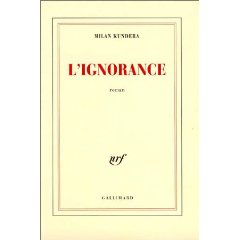Michel Houellebecq (dont il faudra reparler parce qu’au-delà de la légende sulfureuse, c’est peut-être/ou non, un « grand » aussi?), vendredi dernier, sur France Inter,
interrogé sur sa réaction à l’attribution du Prix Nobel de littérature 2008, déclarait n’avoir rien à dire parce qu’il ne connaissait pas Le Clézio!

Jean D’Ormesson (à propos duquel on a déjà tout dit), le même jour, sur France 2,
interviewé par la très souriante Sophie Davant, annonçait que depuis la deuxième moitié du XX° siècle, il n’y avait hélas plus de « grands écrivains ».
-Où sont les Gide, en effet, se lamentait-il?
Et à propos de Le Clézio et de son prix Nobel:
-Je me demande s’il a vraiment la stature d’un grand écrivain!

Après cela, on s’étonnera que la critique américaine annonce la mort de la culture française! Et que Pierre Assouline s’en indigne à juste titre dans un de ses billets récents.
A force de tourner en rond et de mijoter dans son jus, le cénacle littéraire parisien a fini par tuer sa poule aux oeufs d’or. Les sempiternels souvenirs d’enfance bourgeoise des uns (mais tout le monde n’est pas Proust), les descriptions cliniques de la sexualité des autres, les recherches infinies sur la forme, les tribulations à deux sous des midinettes esseulées… Certes. Dieu qu’on s’ennuie à ouvrir la manne de notre show biz littéraire français!
Mais est-ce à dire que la littérature est morte qui s’écrit encore en français?
Allons, allons! A trop avoir le nez dans les piles de lecture imposée, on en oublierait qu’il existe autre chose que la consommation littéraire fast-food, nombriliste ou élitiste.
Heureusement, loin des cercles officiels ou à l’étranger, quelques grands parmi nos écrivains semblent exister encore. Vous avez dit François Cheng ? Philippe Claudel? Michel Houellebecq peut-être? Ou d’autres, Yasmina Khadra, Nancy Houston, par exemple? D’autres qui vous sont chers et que vous avez su déceler? Et Le Clézio, bien sûr, qui nous exhorte:
« Il faut continuer à lire des romans, c’est un très bon moyen d’interroger le monde réel », article du Nouvel Obs.
Interroger le monde réel? En voilà une idée!
Alors nous lui obéirons. Nous continuerons à lire des romans. Mais souvent des romans non imposés par le seul profit éditorial via les plateaux médiatiques complaisants.

Ces pistes de cirque clinquantes qui ne reflètent en rien notre littérature vivante, celle parfois discrète mais qui finit toujours (enfin, on l’espère), par révéler les « grands écrivains ».
Photo: funérailles nationales d’un ‘grand écrivain’, Victor Hugo (1885)
Portrait: Gide par Théo van Rysselberghe
Tableau de Maxime Dastigue (1851-1908): Balzac. Image empruntée au site l’Histoire par l’image
Tableau: Le cirque de Georges Seurat. 1891.