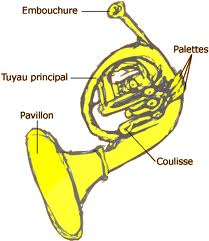C’était une femme talentueuse, Doris Lessing, mais aussi courageuse et ô combien, malicieuse!
 portraits empruntés au site Babelio
portraits empruntés au site Babelio
Une femme née de parents britanniques, en 1919, dans un pays qu’on appelait encore la Perse (l’Iran d’aujourd’hui) et qui grandit en Rhodésie du sud. Une femme qui n’a cessé de puiser dans son expérience pour traquer de sa plume prolixe et lucide, les travers de la société: de l’horreur de l’apartheid, aux déceptions de l’engagement politique, jusqu’aux difficultés à s’inventer en tant que femme. Ses luttes, colères et combats étaient graves, ceux du siècle et de ses illusions perdues, ceux de l’Afrique en marche et de l’Afrique brisée, mais toujours la distance et l’humour l’ont caractérisée.
La reconnaissance tardive de son oeuvre – elle reçoit le Prix Nobel de littérature en 2007, alors qu’elle a 87 ans – ne peut que la faire sourire. Les témoins racontent qu’elle revenait de faire des courses, les bras chargés de paquets, lorsqu’on l’a prévenue de la distinction: « Oh ! mon Dieu! s’est-elle exclamée, ils ont pensé, là-bas les Suédois : celle-là a dépassé la date de péremption, elle n’en a plus pour longtemps. Allez, on peut le lui donner ! »
Icône du féminisme, elle se dégage de toute récupération et ne craint pas d’exercer son jugement sur les dérives qu’elle explique sans ambages: « Après avoir fait une révolution, beaucoup de femmes se sont fourvoyées, n’ont en fait rien compris. Par dogmatisme. Par absence d’analyse historique. Par renoncement à la pensée. Par manque dramatique d’humour. »
Un jour, elle décide de révéler les difficultés des jeunes écrivains et décide de faire une farce à son éditeur en lui proposant deux manuscrits signés d’un autre nom que le sien. Refusés par l’éditeur, « Le journal d’une voisine »(1983) et « Si vieillesse pouvait » (1984), apportèrent la preuve de ce que la romancière voulait dénoncer:
 « J’ai voulu vérifier que seul le succès attire la reconnaissance et le succès. Ceux qui se targuent d’être experts de mon œuvre ne reconnaissent même pas mon style… » Josyane Savigneau, citant ainsi Doris Lessing dans son dernier article relatant la mort de l’écrivain, ajoute: « Elle en savait long, comme tous les grands écrivains, sur le mensonge et l’illusion. »
« J’ai voulu vérifier que seul le succès attire la reconnaissance et le succès. Ceux qui se targuent d’être experts de mon œuvre ne reconnaissent même pas mon style… » Josyane Savigneau, citant ainsi Doris Lessing dans son dernier article relatant la mort de l’écrivain, ajoute: « Elle en savait long, comme tous les grands écrivains, sur le mensonge et l’illusion. »
Révélée en 1950 par son ouvrage « The grass is singing » traduit en français « Vaincue par la brousse », elle rencontre un succès international avec « The golden notebook », en 1962, soit « Le carnet d’or »en français, en 1976, pour lequel elle reçut le Prix Femina.